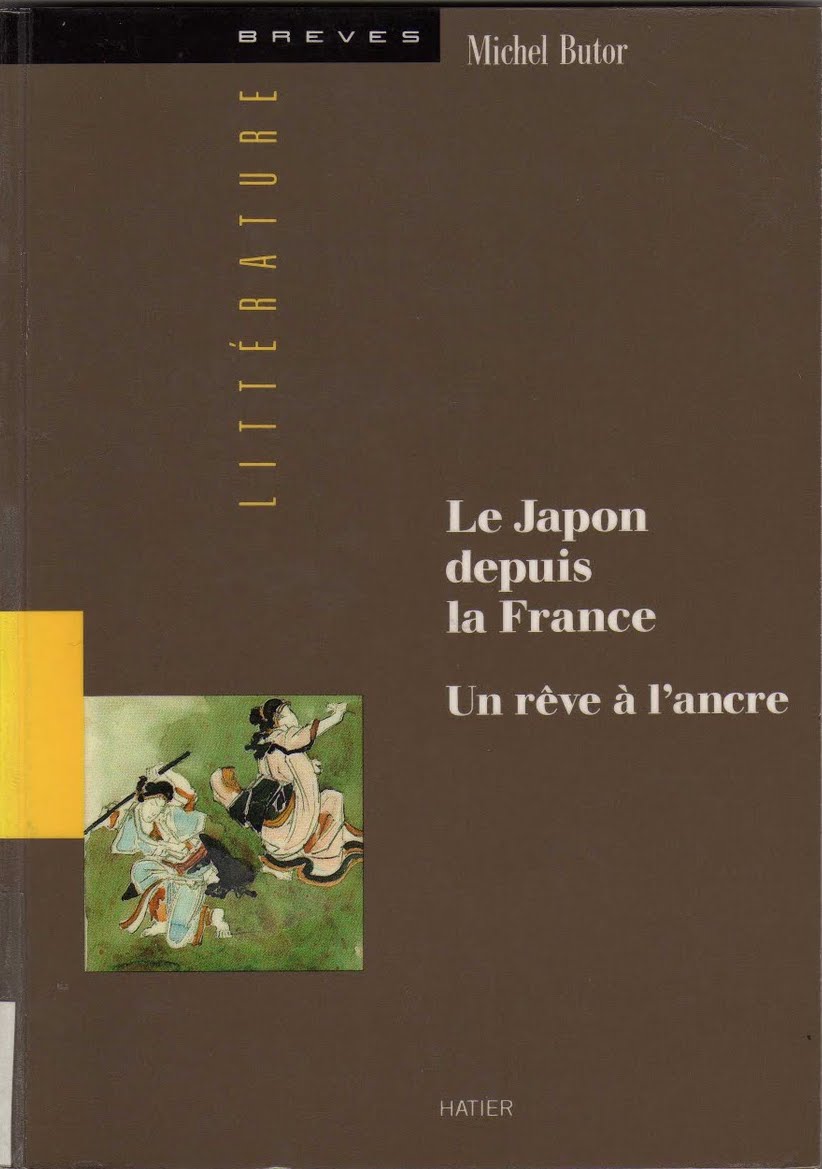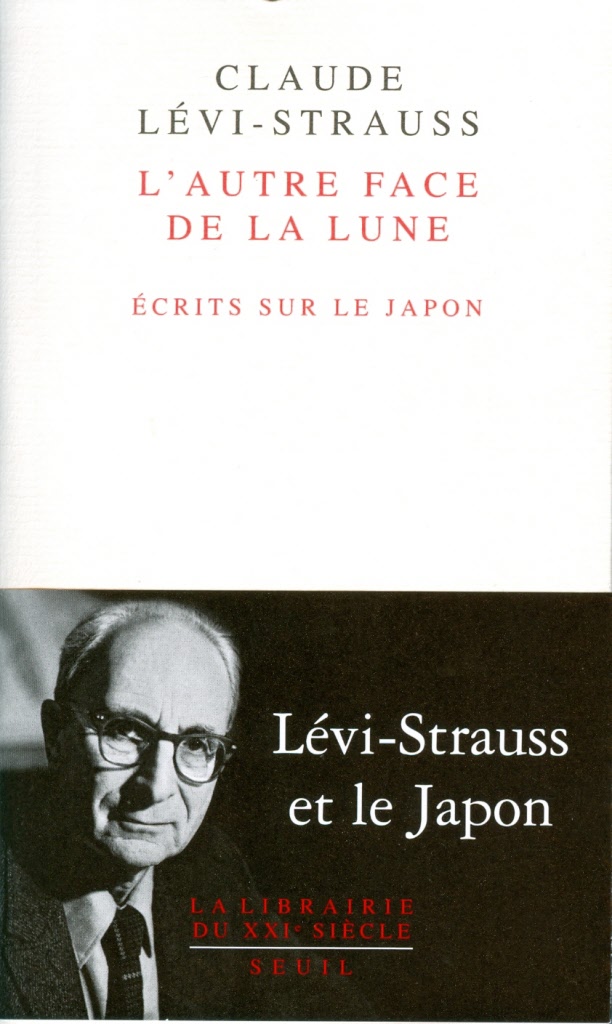Les écrivains français qui voyagent au Japon racontent toujours leur descente d’avion de la même manière : le dépaysement radical, la tête qui tourne, la joie enfantine de se trouver soudain analphabète - la jubilation de sentir que tout cela a un sens, mais qu’il leur échappe. Nos écrivains sont les vaillants explorateurs d’un téléfilm d’aventure, qui auraient gravi les falaises escarpées d’un haut-plateau pour découvrir au sommet une civilisation perdue, isolée mais bien vivante, qui n’attendait que notre science pour être enfin comprise puis disparaître, son destin accompli. Ainsi les couloirs de l’aéroport de Narita deviennent-ils l’entrée d’un labyrinthe aux murs couverts de hiéroglyphes fascinants mais indéchiffrables, au bout duquel on accède à la chambre secrète, au monde perdu, à l’île mystérieuse - au Japon.
|
I.
La première mission diplomatique française au Japon a eu lieu en 1858. Elle avait un objectif clair : signer en urgence un traité bilatéral avec les autorités japonaises pour ne pas être trop à la traîne des Américains et des Britanniques. L’ambassadeur français était le baron Gros (lol), et il était assisté du marquis Charles-Gustave de Chassiron, qui a eu la bonté de nous laisser un récit de voyage complet et fort bien écrit : Notes sur le Japon, la Chine et l’Inde.
Bref lisez-le, sincèrement on dirait du Borges, surtout que l’OCR de la version disponible en ligne est particulièrement dégueulasse, ce qui accrédite l’idée que le livre sort tout droit de la bibliothèque de Babel
C’est un livre extraordinaire : il y a de l’exotisme, de l’aventure, du mystère, et, évidemment, des îles. On passe par Dejima, on croise des Américains sans scrupules, des Anglais fourbes et des gentilshommes de fortune, des gardes du corps obtus et des diplomates mielleux, des escrocs et des princes, des problèmes de traduction et des faux-semblants. On s’interroge sur les intentions de l’énigmatique baron Gros, toujours enfermé dans sa cabine, on tremble quand le choléra commence à se répandre dans les quartiers des marins de leur corvette à vapeur, on frémit quand Chassiron et ses compagnons découvrent une carte de Tokyo chez un marchand d’estampes et tentent une sortie nocturne pour comprendre à l’intérieur de laquelle des enceintes concentriques de la ville ils sont confinés. Tokyo est un labyrinthe dont il cherche à percer les mystères. Derrière la muraille, quelque part au bout d’un chemin tortueux, il y a nécessairement le vrai Japon.

Tout le rapport des Français au Japon est déjà là : les geishas, les estampes, les théories fumeuses sur les idéogrammes, la fascination pour l’artisanat, et déjà Chassiron se désolant de voir le Japon authentique et pur disparaître sous l’effet de la corruption de l’Occident.
|
Comme tous les Occidentaux de l’époque, il trouve les Chinois sales et fourbes et bruyants
En 1890, le bourgeois toulousain Georges Labit fait à son tour un voyage en Orient. Après la Chine qui lui déplaît beaucoup, il arrive au Japon.
Je ne résiste pas à l’envie de vous livrer in extenso le contenu de l’annexe de son passeport, qui donne une idée des actes inqualifiables dont les Occidentaux en visite au Japon se rendaient régulièrement coupables :
« Les Règlements locaux ci-dessus mentionnés défendent notamment ce qui suit :
1° de voyager la nuit, en voiture ou à cheval, sans lanterne ;
2° d’aller à cheval sur le théâtre d’un incendie ;
3° de passer dans les lieux où la circulation est interdite ;
4° de galoper dans les chemins étroits ;
5° de négliger ou de refuser d’acquitter les droits de péage sur les bacs et les ponts ;
6° de détruire ou de dégrader les affiches, les enseignes ou les poteaux marquant les distances ;
7° de tracer des caractères ou des dessins sur les murs des temples et des habitations particulières ;
8° de causer du dommage aux récoltes, aux arbres, aux terres cultivées et à toute espèce de biens, sur les routes et dans les jardins publics ; d’intercepter, d’une manière quelconque, le cours des eaux dans les fossés, canaux, etc.;
9° de traverser les champs, plantations, enclos et autres lieux réservés ;
10° d’allumer imprudemment du feu dans les forêts, sur les montagnes ou dans les plaines. »
Son récit nous semble extrêmement familier, parce que son expérience du Japon est impeccablement touristique : « Il y a quelques années à peine, peu de personnes osaient entreprendre un voyage au Japon », écrit-il. « Aujourd’hui, l’accès en est facile. En s’embarquant sur les splendides steamers des Messageries-Maritime à Marseille, on est rendu à Yokohama en quarante-deux jours ». Labit reste quelques mois au Japon, où il se déplace en charrette à bras, plus « authentique » que le train, visite des temples, des onsen. A la recherche du pittoresque et de l’authentique, Georges Labit rejette en bloc les quartiers européens de Yokohama, dont l’architecture récente et occidentalisante lui paraît bien fade. Lui, ce qu’il veut voir, c’est le vrai Japon. Evidemment. Mais comme d’habitude, le vrai Japon est déjà parti. « Toute trace du système féodal a disparu aujourd’hui du Japon, et ce qu’il en reste, ce sont de vieilles armures, de vieux sabres offerts et mis en vente par des fripiers, qui souvent ne sont eux-mêmes que d’anciens samouraï. »

Labit émet naturellement de ces jugements définitifs sur un peuple et son histoire qui font tout le sel des récits de voyage du XIXe. Mais il ne faut pas être trop dur avec lui. La candeur avec laquelle il relate ses aventures lui permet de ne pas dire trop de sottises sur bien des points : l’absence de pudeur supposée des Japonais qui n’est en réalité qu’un autre rapport au corps, leur rapport très simple à leur religion, [« La religion est, au Japon, familière et peu gênante. »], leur langue [« La langue japonaise qui est, pour le savant, hérissée de difficultés, présente au voyageur un ensemble de locutions faciles qui permet en peu de temps de s’entretenir des choses usuelles. »], leur modernisation effrénée. « On ne pratique plus le hara-kiri au Japon », conclut Labit, « mais par contre l’assassinat des ministres est très fréquent ».
|
|
Il y a tout de même un épisode qui mérite d’être raconté. De passage à Asakusa, Labit visite le panorama, assiste à des combats de sumo et à des spectacles de prestidigitation. « Une de ces baraques foraines nous étonna surtout. Sur la porte était une inscription que nous traduisit M. Fouque : ‘Aux Merveilles de la civilisation’. A l’intérieur, à la façon des orchestres de dames viennoises, se trouvaient quatre ou cinq Japonaises faisant de la musique soi-disant européenne. Elles étaient affublées d’horribles défroques, ayant eu maints possesseurs en Angleterre, sans souliers aux pieds, et portaient des chapeaux qui avaient dû plus d’une fois faire la traversée du Pacifique ; un pitre, fort sérieusement, expliquait aux spectateurs, accroupis sur des nattes, l’électricité et la vapeur. »
ou, peut-être, un Japonais visitant la Japan Expo
On croirait lire n’importe quel Français rentrant aujourd’hui de voyage et ayant goûté « ce que ces barbares appellent des croissants / du fromage / une baguette / du saucisson / du vin ».
|
On peut rire de l’attitude impeccablement touristique de George Labit, qui ne comprend rien au kabuki et galère à manger avec ses baguettes, mais le portrait qu’il fait du Japon est infiniment plus lucide que celui peint par un autre voyageur français à l’époque, Pierre Loti.
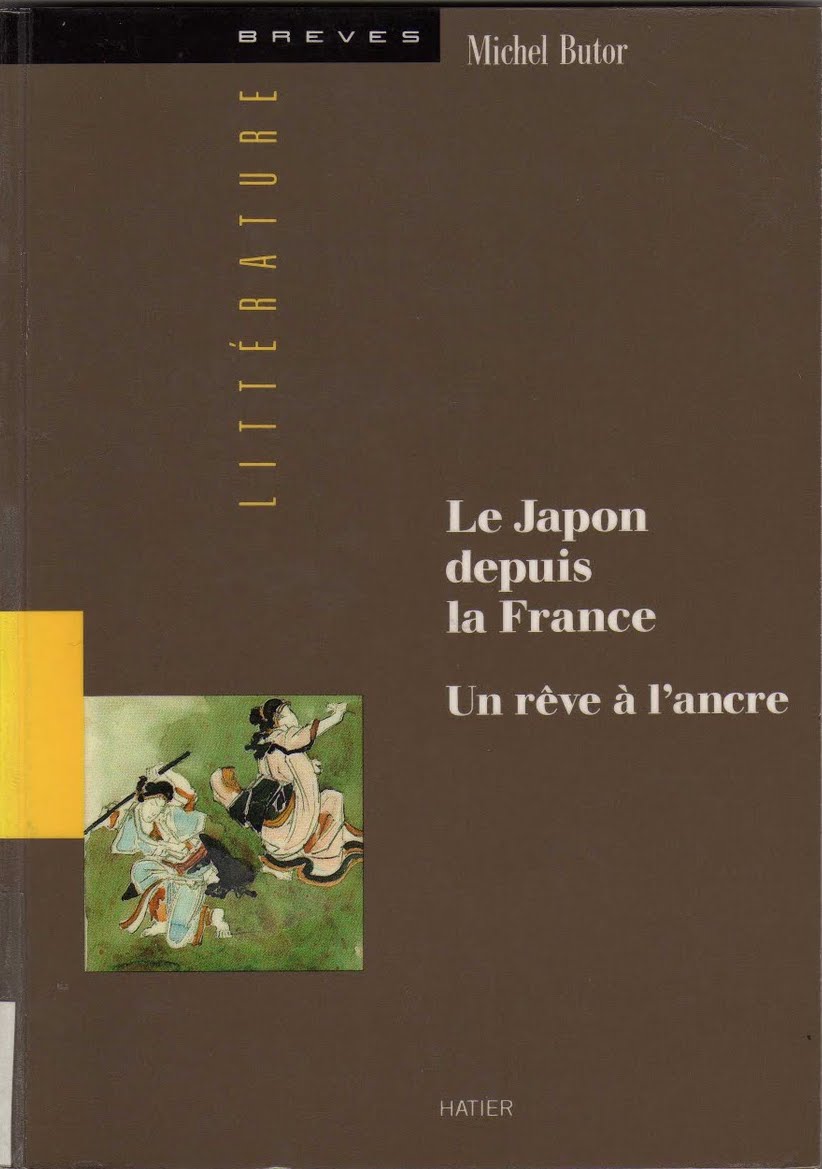
Pierre Loti, écrivain, académicien et marin, ira trois fois au Japon en mission militaire officielle, à peu près à la même époque que Labit. Il en ramènera chaque fois un livre plus ou moins autobiographique, comme la majorité de ses romans. Le premier, Madame Chrysanthème, est celui qui rencontre le plus grand succès et aura le plus d’influence. « A le relire aujourd’hui, on est gêné par son caractère artificiel, par son manque de sympathie », écrit Michel Butor, « mais il est certain que l’image qu’une bonne partie des Occidentaux se sont faite du Japon en vient. »
En particulier, Loti va populariser l’idée que le Japon est un pays minuscule, étrange et délicat. « Le minuscule est un thème essentiel de la description du Japon en Occident à la fin du XIXe siècle », écrit toujours Butor « Petits arbres, petits objets, petite vaisselle, petites maisons. Nulle raison de s’inquiéter : on peut y considérer les choses comme des jouets. »
Le succès des romans de Loti façonnera les lieux communs sur le Japon dans la littérature française :les clichés sur le Japon délicat et la Chine grossière se multiplient. « Le Japon pour Loti n’est pas un pays à prendre au sérieux », explique Butor « Il apporte un comique spécial dont on peut profiter, mais si on le prenait par trop au sérieux, il risquerait de se révéler dangereux. Il est important de laisser le Japon en train de s’ouvrir à un certain niveau d’infériorité. »
L’idée qui résume le mieux ce rapport de Loti au Japon est sans doute la « saugrenuité », un terme qui apparaît dès l’avant-propos de Madame Chrysanthème puis revient sans cesse. Butor toujours : « Dans le Japon de l’époque de Meiji, deux cultures se heurtent avec une violence extraordinaire. Les objets européens vont trouver au Japon un contexte différent, et en général y être utilisés avec une certaine maladresse qui fera rire les Occidentaux. Le comique de Molière repose en particulier sur la bourgeoisie de l’époque de Louis XIV qui essaie d’imiter les nobles et n’y arrive jamais. Pour le noble, il est indispensable que le bourgeois veuille l’imiter et qu’il n’y arrive pas. Le jour où le bourgeois décide de ne plus imiter le noble, c’est la Révolution française qui commence, et cela n’a plus rien de comique. Pour l’Occidental de l’époque de Meiji, un comique du même type apparaît dans la mesure où l’Occidental se sent être un modèle adopté par les Japonais dans quantités d’aspects de la vie quotidienne, modèle qui reste alors inégalé. C’est l’échec de l’autre dont on jouit, car il rassure. C’est ce sentiment qui est marqué par ce terme ‘saugrenu’ »
|
Le plus surprenant à la lecture des textes du XIXe est le point auquel les Occidentaux étaient conscients de faire œuvre de colonisation. Ils parlent sans cesse de leurs intérêts à protéger, de leurs valeurs et de leur culture, qu’il faut à tout prix apporter aux peuples moins civilisés, etc. Le marquis de Chassiron est sincèrement persuadé de la valeur civilisatrice de sa mission diplomatique, qui lui paraît fondamentalement différente de l’impérialisme britannique et de l’expansionnisme commercial des Américains.
Les Japonais ne s’y sont pas trompés, et ils ont donc tout mis en œuvre pour être traités en égaux par les Occidentaux. Leurs efforts pour se joindre aux colonisateurs sont perçus comme mignons, divertissants, saugrenus, mais inspirent tout de même un certain respect. Le baron Gros, le premier ambassadeur français, veut flatter ses hôtes en disant des Japonais qu’ils sont « la nation la plus civilisée d’Orient », et s’étonne que son compliment ne soit pas mieux reçu. Regardez un peu ces curieux petits sauvages, avec leurs dignitaires pléthoriques et leurs étranges costumes !
(Lors de son troisième et dernier séjour au Japon, Loti change de regard et fait une expérience quasi mystique sur une île - on en reparlera, évidemment)
Dans sa correspondance mondaine, Loti s’applique à gommer totalement la nature militaire de ses séjours au Japon. « Il n’empêche qu’il transparaît chez lui aussi cette face sombre du regard porté sur le Japon, cette crainte qu’il inspire, d’un côté aux politiques et aux militaires, et de l’autre aux esthètes qui comme lui n’aiment rien tant dans les pays d’Orient que de leur permettre de célébrer les civilisations antiques, à condition qu’elles aient irrémédiablement disparues. » C’est ça le sens profond de la saugrenuité que Pierre Loti et tant d’autres vont chercher au Japon : une altérité rassurante.
|
Les collections du marquis de Chassiron
Lors du voyage diplomatique de 1858, Chassiron avait acheté moults estampes et bibelots (à grand peine, puisque ses gardes du corps devaient contrôler laborieusement tout ce qu’il achetait). Il était un des précurseurs d’une mode des « japonaiseries » qui ne se démentira pas en France et en Europe, pendant des décennies. Les collectionneurs aiment en particulier les petits objets très ouvragés, spécialement les netsuke, des objets normalement destinés à retenir les choses que l’on transporte accrochées à la ceinture de son kimono.
George Labit avait lui aussi rapporté quantité d’objets de ses voyages en Orient - du Japon il a évidemment rapporté une armure de samurai, des masques de nô, des photos de Felice Beato, et quantité d’estampes et de netsuke. Pour exposer ses collections, il fit construire à Toulouse une vaste villa, dans un style qu’on qualifiera diplomatiquement de néo-mauresque ou d’éclectique, toutes manières polies de dire qu’elle empile les styles, les époques et les références.

Il est totalement absurde de collectionner les netsuke, surtout si l’on ne possède pas de kimono
Pendant toute la fin du XIXe siècle, les estampes et objets japonais sont donc vendus, collectionnés, accumulés, à Paris et en Europe, sans jamais être remis dans leur contexte, tels des « arts premiers » vidés de leur signification. Tous ces objets sont appréciés comme des artefacts d’une civilisation disparue et à jamais inconnaissable.
Evidemment, ce malaise n’échappait pas aux Japonais - il faut penser à Tanizaki et à son Eloge de l’ombre, qui s’ouvre sur une description de la difficulté de cacher des fils téléphoniques dans une maison japonaise traditionnelle.
« Lorsque Loti va au Japon », écrit Michel Butor, « il découvre ce pays à travers l’écran d’une occidentalisation difficile. En opposition avec ce malaise, le Japon de l’ère edo peut apparaître comme une harmonie perdue. L’Européen sensible qui va au Japon à cette époque voit bien que l’introduction de certains objets européens jure avec l’ensemble japonais ; donc il a tendance à rêver du moment où cet ensemble était seul. Ainsi Edmond de Goncourt, qui n’a jamais été au Japon, se représente à travers les objets de sa collection et surtout les grandes estampes classiques un Japon en train de disparaître.[…] Malgré toutes les études considérables qu’il a faites pour se documenter, comme il était incapable de consulter des sources japonaises, son livre fourmille d’erreurs qui nous semblent aussi grosses que celles de Voltaire, mais, n’ayant pas les préjugés d’officier français de Loti, il est capable de jouir du Japon de façon bien plus harmonieuse. »
Il faut aussi penser à Emile Guimet, mu par une passion accumulatrice tout à fait sincère et qui nous a laissé un beau musée, mais qui ne prit jamais la peine de rien apprendre des pays qu’il pilla allègrement. Comme les Goncourt à la même époque, comme Loti, il entendait juger de la valeur esthétique des objets qu’il achetait abstraction faite de leur usage, de leur origine et de leur époque, selon ses catégories esthétiques propres.
|
Cette accumulation de japonaiseries aura des conséquences inattendues, puisqu’elles influenceront plus ou moins directement la production artistique européenne des décennies suivantes, des impressionnistes à l’atelier viennois.
Koloman Moser, illustration pour la revue Ver Sacrum (1901)
C’est touchant parce qu’on a les lettres où Van Gogh s’enflamme pour le Japon, dont il espère retrouver le climat en Provence, les dessins où il recopie Hiroshige en écrivant n’importe quoi à côté, comme un petit enfant qui ferait semblant d’écrire. Il lit Madame Chrysanthème de Loti pour y apprendre des choses sur le Japon, comme les gens de ma génération ont cru tout savoir des Japonais en lisant Amélie Nothomb. Van Gogh est d’ailleurs persuadé que « l’art japonais est en décadence dans sa patrie ». Comme tout le monde.
|
Que pensent les Japonais de tout cela ? Passé le choc de l’ouverture, ils se savent observés. Ils savent que les visiteurs occidentaux écrivent des récits de voyage et qu’ils leur servent de matériau - par exemple pour le journaliste américain Lafcadio Hearn, dont j’ai déjà parlé une fois. Hearn est un aventurier qui a trouvé sa vocation d’ethnographe en arrivant au Japon en 1890, après avoir fait le tour du monde. Ses livres extrêmement populaires jouaient, eux aussi, sur l’idée d’un Japon authentique et corrompu par la modernité. « Il a entrepris d’expliquer à ses lecteurs occidentaux, livre après livre, ce mystérieux pays nommé ‘Japon’. », écrit Damian Flanagan « Hearn croyait pouvoir capturer le cœur (kokoro) caché des Japonais en observant soigneusement le monde qui l’entourait. Il a également découvert que cet ‘autre monde’ lui permettait de plonger dans les replis de son propre esprit. »
Hearn connaîtra une triste fin : dans un élan romantique mais malvenu, il avait décidé de prendre la nationalité japonaise afin de pouvoir épouser sa femme japonaise sur un pied d’égalité. Il perdit immédiatement tous les privilèges associés à sa qualité d’occidental, ainsi que son poste à l’université de Tokyo, et mourut dans une misère complète peu de temps après, en 1904. L’ironie du sort a voulu que son poste à l’université de Tokyo revienne à Natsume Soseki, sans doute le romancier japonais le plus lu et le plus commenté, qui rentrait tout juste de Londres. Soseki avait été envoyé en Angleterre à grand frais par le gouvernement japonais, avec la mission de devenir un expert en littérature occidentale. Il y avait passé deux années horribles, vivant dans la misère et ayant les plus grandes difficultés à communiquer. C’est peu dire que l’expérience lui avait été pénible - il s’était senti pauvre, petit, gauche et incapable - et on s’étonne souvent qu’il ait choisi, à son retour, de parler d’autre chose, de ne pas raconter.
Pour Damian Flanagan, ce que Soseki a ramené de son voyage, c’est un regard extérieur, non pas sur l’Occident, mais sur le Japon. « L’aliénation dont Soseki a d’abord fait l’expérience à Londres lui a permis de porter un regard neuf tant sur lui que sur la société japonaise en général, et il allait bientôt faire appel à une satire swiftienne pour décrire le Japon lui-même. » Le fameux chat de Soseki n’est autre qu’un renversement et une subversion du regard ethnographique que prétendaient porter les Occidentaux amusés sur les coutumes et l’esthétique japonaises. « Soseki rejetait l’idée qu’un écrivain (ou même un peintre) décrivait le monde qui l’entourait. Il pensait plutôt qu’un artiste décrivait le reflet du monde tel qu’il avait été transformé par le mirroir de sa propre conscience. »
En ce sens, Soseki est peut-être le seul à être conscient que ce qui vient, ce qui remplace le Japon féodal, est encore le Japon. Un Japon neuf et incompréhensible, mais un Japon quand même.
¦
¦
II.
Je ne sais pas bien ce que les écrivains français vont toujours chercher au Japon. L’exotisme, évidemment - ils disent « un choc esthétique », « une autre perspective », des trucs comme ça -, une culture dont ils ne savent rien mais qu’ils n’osent pas mépriser tout de suite, avant de l’avoir vue de leurs yeux.
Et puis l’altérité du langage, le plaisir et la surprise de se trouver à nouveau analphabète, si bien que leur descente d’avion devient toujours, à les entendre, une forme de retraite au milieu de signes lourds de sens mais indéchiffrables. La différence est telle qu’ils comptent toujours découvrir quelque chose de vierge et de pur, de non contaminé, un conte moral qui offrirait un excellent contrepoint à tout ce qu’ils ont envie de raconter sur eux et sur la France, au fond.
Au retour ils ne peuvent jamais s’empêcher d’écrire un livre, qui parlera toujours plus d’eux-mêmes, de leur époque et de la France, que du Japon.
|
D’une manière générale, tout le monde a des commentaires à faire sur la langue japonaise et ses « idéogrammes », tout le monde trouve mer-veil-leux le concept de mono no aware, mais peu nombreux sont ceux qui prennent la peine de se documenter avant de commencer à déblatérer, sans même parler d’apprendre le japonais, évidemment. Claude Lévi-Strauss est un des rares auteurs que j’ai vu s’excuser de ne pas savoir le japonais en préambule à une conférence (ou même à seulement considérer que c’est un problème).
Michel Butor dit par exemple de Paul Claudel : « A Tokyo, il s’est passionné pour la culture japonaise, sans connaître la langue naturellement. » Naturellement. Claudel a rêvé toute sa vie du Japon, il a choisi la carrière diplomatique dans l’espoir d’aller au Japon, mais naturellement il n’a pas pris la peine d’apprendre le japonais ?
|
Parenthèse : Henri Michaux constitue un cas particulier et intéressant. Il arrive au Japon en 1934, au terme d’un long voyage qu’il raconte dans Un Barbare en Asie. « Enchanté par la plupart des pays parcourus, [Michaux] a été profondément déçu par le Japon, et rétrospectivement il se demande comment il a pu être si aveugle », écrit Michel Butor. « Pendant son voyage, Michaux a été rebuté par le développement militariste du Japon, qui allait tourner vers les alliances que l’on sait. » Vu d’aujourd’hui, le texte de Michaux paraît violemment raciste. Pour autant, je trouve ces accusations d’aveuglement assez étranges. Le Japon militariste de Taïsho aurait-il été tout excusé s’il n’avait pas eu le mauvais goût de s’allier avec les Nazis ? Butor écrit encore que « quelque chose l’empêchait de les voir [les beaux arbres du Japon], ce rideau de bruit militaire qui l’a tellement hérissé qu’il a fermé les yeux dès qu’il voyait justement ce aurait dû l’attirer » - le dégoût de Michaux me paraît non seulement compréhensible, mais parfaitement honorable.
En 1967, Michaux consent finalement à une réédition de son livre, mais seulement après lui avoir ajouté de nombreuses notes, excuses et repentirs, expliquant que le voyageur d’aujourd’hui ne pourrait sans doute plus voir au Japon ce qu’il y avait vu dans les années 30. Michaux a été ratrappé par le consensus.
|
Et puis bien sûr il y a Roland Barthes. Dans L’Empire des Signes, il annonce d'emblée qu’il ne parlera pas du Japon. Il dit seulement : « là-bas », en italique et tout, pour qu’on sente bien tout l’oblique de la situation. Il avait découvert le Japon comme un collégien rencontrerait son professeur au supermarché, réalisant soudain que ce dernier n’habite pas dans un placard de la salle de classe. Regarde, chéri, regarde leurs maisons en papier, leurs marionnettes, leurs sceaux – regarde, c’est prodigieux, regarde comme ces petits hommes sont ingénieux ! Mais sitôt revenu de son émerveillement, Barthes se désole de trouver le Japon authentique, sauvage, etc. — son Japon — proprement gangrené par une modernité odieusement familière, toute en plastique et en métal. « Le Japon entre dans sa mue occidentale », écrit-il, « il perd ses signes, comme on perd ses cheveux, ses dents, sa peau ; il passe de la signification (vide) à la communication (de masse) ». Comme Chassiron, comme Loti, comme Zola, Barthes se désole que le Japon ait déjà disparu.
Barthes « se rend compte que le Japon qu’il décrit est imaginaire, mais il insiste sur le fait que le Japon réel a certains traits qui lui ont permis d’imaginer ce pays de liberté interprétative », tempère Butor. Il est bien embêté parce que souvent le livre de son ami sonne tout à fait faux. Il estime que c’est la faute au jargon structuraliste de Barthes, qui a mal vieilli - je ne sais pas si c’est exactement ce dont il parle, mais il est vrai que c’est surtout quand Barthes s’avise de parler de la langue japonaise que ça sonne faux.
Finalement le regard que portent les écrivains français du XXe sur le Japon n’est guère différent de celui que portaient Guimet ou les Goncourt : l’idée fondamentale est que leurs vues universelles leur permettent de juger intelligemment de la production et de la langue d’un peuple dont ils ignorent tout. Les écrivains français sont formés à la dissertation : persuadés que quelles que soient les questions auxquelles ils seront confrontés, leur rhétorique et le réservoir des citations classiques leur permettront toujours de briller et de dire, au fond, ce qu’ils ont envie de dire, en le tordant tant et si bien qu’ils finiront bien par sembler répondre au sujet.
|
C’est la même chose dans les journaux d’aujourd’hui avec l’Allemagne - combien de germanistes parmi ceux qui nous abreuvent de leurs théories sur la réussite ou l’échec du « modèle allemand » ?
Les Français cherchent au Japon un prétexte à parler de la France, à la manière d’un roman d’anticipation où le futur imaginé n’est qu’une projection, une caricature, et finalement un biais pour parler du présent.

La première fois où j’ai lu un combat de cyborgs au découpage hystérique et ponctué de citations de Nietzsche et Jung, je dois avouer que ça m’a fait quelque chose.
Au Japon, nous cherchons d’abord ce qui nous ressemble, parce que pour toutes nos prétentions à l’objectivité, nous laissons toujours nos catégories esthétiques nous trahir. Tel Georges Labit qui s’ennuie à pleurer au théâtre, c’est plutôt à Jiro Taniguchi qu’à Yukito Kishiro que nous donnons des prix quand nous décidons de nous intéresser au manga - alors que GUNNM s’avère une œuvre chaque jour plus visionnaire, mais qui ne correspond pas à nos catégories esthétiques.
L’analyse de Lévi-Strauss : « Or, fait paradoxal, en Europe, cette indépendance, cette autonomie respective du dessin et de la couleur ont suscité l’enthousiasme des Impressionnistes, qui dans leur art ont fait tout le contraire ; s’ils l’avaient véritablement comprise, l’estampe japonaise n’aurait pas conduit à Monet, à Pissaro ou à Sisley, mais aurait plutôt provoqué un retour à Ingres, chez qui nous trouvons exactement ce même dualisme qui choquait, d’ailleurs, ses contemporains. »
En soi, ce n’est pas nécessairement un problème. Le japonisme n’avait peut-être pas compris grand chose à la peinture japonaise, il n’en a pas moins inspiré réellement les artistes européens. Mais dès lors, que reprochons-nous aux Japonais, exactement, lorsqu’ils s’emparent des Nibelungen, de Jules Verne ou d’Arsène Lupin pour les cuisiner à leur sauce ? Ils ne sont pas plus cavaliers que nous, et ce qu’ils découvrent en s’appropriant notre culture, ce qu’ils y voient, n’est pas moins vrai que ce que nous voyons dans leur production, même lorsqu’elle nous demeure imperméable ou que nous la simplifions grossièrement.
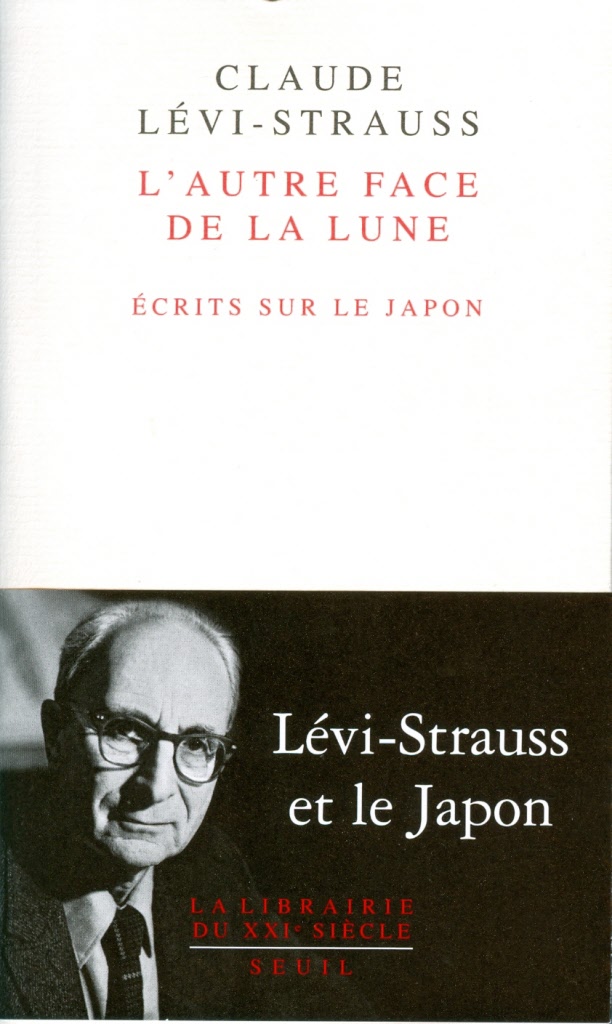
Lévi-Strauss justifie ainsi ses propres approximations : « Et cependant, au moment même où l’auditeur occidental croit atteindre le fond de l’âme japonaise, révélé par la concordance de deux registres [la gamme de la musique japonaise et le mono no aware, en l’occurrence], il commet probablement plusieurs contresens. […] Mais il se pourrait aussi que les connaissances inévitablement mutilées de celui qui contemple une culture par le dehors, les grossières erreurs d’appréciation qu’il est exposé à commettre eussent leur contrepartie. Condamné à ne regarder les choses que de loin, incapable d’en percevoir le détail, l’anthropologue doit peut-être à ces insuffisances d’être rendu sensible à des caractères invariants qui se maintiennent ou s’affirment sur plusieurs plans dans la culture, et qu’obscurcissent ces différences mêmes, qui lui échappent. »
Butor ne dit pas autre chose lorsqu’il assure que Roland Barthes a raison, mais raison « sans le savoir et autrement qu’il le croyait ». L’honnêteté m’oblige à dire que c’est l’espoir sur lequel repose souvent mes propres textes.
¦
¦
Il enchaîne sur une série de poèmes en prose auxquels je n’ai strictement rien compris
J’ai toute la tendresse du monde pour cet aveu de Michel Butor, à la fin de son livre sur les écrivains français au Japon : « Dans les instants qui me restent, je voudrais vous faire part de mon propre désarroi. J’ai fait défiler devant vous de nombreux textes français à propos du Japon ; que puis-je faire mon tour venu ? Car il faudra bien que je parle du Japon, cela fait 23 ans que j’essaie. »
Oui parce qu’il faut m’interroger sur mon propre rapport au Japon. Pourquoi est-ce que je me permets de me moquer de Van Gogh, moi qui pérore publiquement depuis des années sur le Japon et ses habitants, sans y avoir jamais mis les pieds ? Qu’est-ce que je cherche ici ? Pourquoi est-ce que quand je me demande où aller vivre, je rêve de Berlin et Montréal plutôt que de Tokyo ? Pourquoi est-ce que je m’acharne pourtant à apprendre le japonais ?
|
Dans Un autre Japon, Nielѕ Ρlanel raconte les années qu’il a passées dans l’entourage de Naoki Inose, puis du premier ministre de l’époque, Junichiro Koizumi. Honnêtement c’est écrit avec les pieds et pas passionnant, mais le début du livre a le mérite de saisir avec juste ce qu’il faut de mièvrerie et de clichés le Japon du début des années 2000, celui d’après la bulle, le Japon de GTO, des ganguro, des G-Shock et des RX-5, etc., c’est-à-dire mon Japon.

|
« Depuis le vingtième étage d’un hôtel qui domine la place principale de la gare de Shibuya, quartier branché et monstrueusement surpeuplé, la vision, à l’instant précis où les feux pour piétons de l’immense carrefour passent tous au vert, est extraordinaire : une nappe humaine de centaines et de centaines d’individus se déplace et recouvre tout, déborde entre quelques voitures bloquées là, puis se déverse sur l’autre rive, avant de se disséminer.
Des lycéennes en uniformes aux longues chaussettes, des jeunes filles habillées façon Barbie, des hommes d’affaires en complet anthracite, des vieilles dames parfois vêtues d’un kimono, des jeunes au look étrange, des femmes, la trentaine, vêtues à l’ancienne mode occidentale, sac Louis Vuitton au bras, des écoliers, petit chapeau jaune écrasé sur la tête comme une crêpe, des ouvriers, clope à la bouche, savourant leur paresse, des quinquagénaires usés qui n’ont plus que quelques cheveux sur le chef - que les Japonais surnomment cruellement ‘codes barres’ -, des policiers à vélo, un yakuza paisible promenant son molosse, des salarymen ‘taciternes’ - un néologisme que j’ai conçu pour eux -, mais joviaux quand ils tombent la veste, un vagabond crasseux et barbu qui, pour ne pas perdre la face, ne fait la manche qu’auprès des étrangers - les Nippons refusent l’aumône aux mendiants -, des étudiants distribuant des paquets de mouchoirs publicitaires, des hommes loupiottes vantant les tarifs de quelque karaoké, quelques prostituées qui vous disent en anglais ‘I love you, come on!’, des Coréens ou des Chinois fondus dans la masse, des gens seuls, des groupes de quatre ou cinq femmes qui se retrouvent pour sortir, des jeunes devant un bar qui ont trop bu et roulent par terre, un couple qui a honte de se tenir la main mais s’embrasse discrètement derrière une colonne, un rebelle jouant du didgeridoo. Tous les visages rencontrés sont encadrés d’une chevelure originellement noire, des yeux bridés vous regardent, vous observent, vous sont indifférents ou vous sourient ; autour de vous, on parle japonais. »
A la lecture de ce paragraphe pourtant pas fameux (ne m’écoutez pas, c’est la jalousie qui parle), je suis à mon tour saisi par la nostalgie, le pathos de l’impermanence des choses. La vérité c’est que j’ai peur d’aller au Japon, parce que je sais que le Japon que j’aime n’existe déjà plus.
|
« Et pourtant je ne suis jamais allé au Japon », écrit Lévi-Strauss dans la préface à la première édition japonaise de Tristes Tropiques. « Non que les occasions aient manqué ; mais sans doute, dans une large mesure, par crainte de confronter à l’immense réalité ce qui reste encore pour moi ‘le vert paradis des amours enfantines’. »
Claude Lévi-Strauss a finalement visité le Japon pour la première fois à 69 ans. Et pourtant, raconte-t-il, « nulle influence n’a plus précocement contribué à ma formation intellectuelle et morale que celle de la civilisation japonaise. » Il relatera en plusieurs occasions la naissance de sa passion pour le Japon : son père, artiste peintre, lui offrit un jour une estampe de Hiroshige en récompense d’une bonne note. « Bouleversé par la première émotion esthétique que j’eusse ressentie, j’en tapissai le fond d’une boîte qu’on m’aida à accrocher au-dessus de mon lit. L’estampe tenait lieu du panorama qu’on était censé découvrir de la terrasse de cette maisonnette que, semaine après semaine, je m’employais à garnir de meubles et de personnages en miniature, importés du Japon ».
Remplacer « estampe » par « Rampo » ou « Satoshi Kon » pour obtenir un aperçu de mes (rares) conversations avec des Japonais.
De là Levi-Strauss passe en mode full-weeaboo, dépensant toutes ses économies en « illustrés » et sabres japonais dont il s’obstine à déchiffrer les inscriptions qui les ornent, muni d’une « liste de caractères japonais ». « Combien de fois me suis-je entendu dire que je m’intéressais là à des choses vulgaires qui n’étaient pas le véritable art japonais, la vraie peinture japonaise, mais relevaient du même niveau que les caricatures que je pourrais découper aujourd’hui dans Le Figaro ou L’Express ! »
Et chacun se désole de trouver, en arrivant, un pays qui semble n’être plus que l’ombre des fantasmes qu’il avait projetés sur lui.
Bref, chacun construit son Japon pour représenter l’époque, pour projeter ses fantasmes, pour se mesurer à quelque chose. Une caricature, une fable, un conte moral. Un paysage composite, lourd de sens, clos sur lui-même. Un miroir, un panorama, une île.
×
Epilogue : Les collections du marquis de Chassiron sont toujours conservées à La Rochelle. Le musée d’Orbigny-Bernon qui les exposait a fermé en 2012, et j’attends avec une certaine impatience que le musée des Beaux-Arts qui en a hérité se décide à les exposer à nouveau, pour pouvoir jeter un œil à ses armures de samurai et à ses netsuke.
Par ailleurs j’ai longtemps cru (et on peut encore lire, ici ou là) que le marquis de Chassiron avait donné son nom au célèbre phare de Chassiron, à la pointe nord de l’île d’Oléron. C’est probablement faux, mais ça me donne tout de même l’occasion de vous parler de ce phare, dont les rayures noires et le jardin m’évoquent nécessairement la tour qui domine l’île panorama.
Il n’y a pas de hasard, vous dis-je. Tout est sur l’île.
|
Prochain épisode :
Le labyrinthe
Où l'on verra qu'il est difficile de s'interdire de voir du sens dans la fiction.
¦
¦
|
|